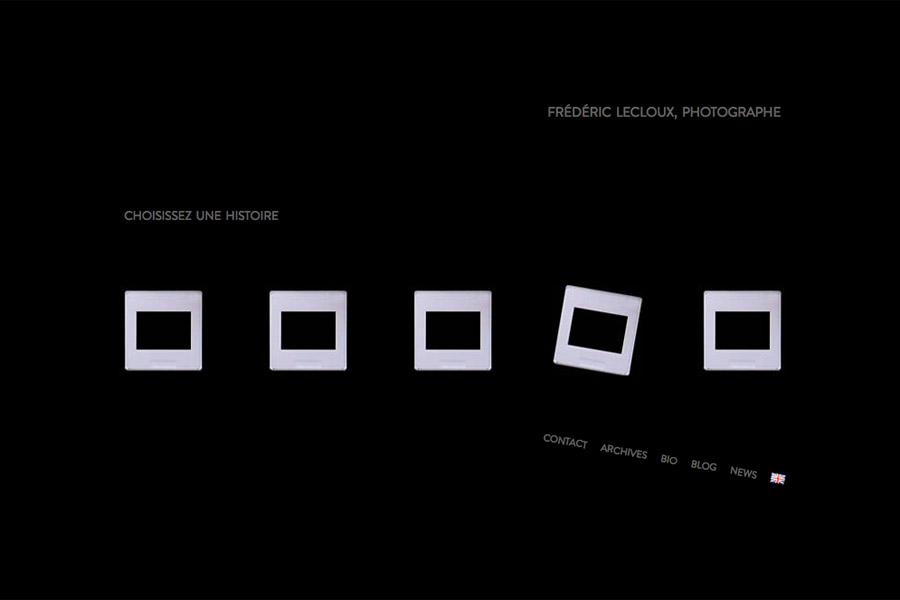
Façons d’être en ligne
Le flux est monté. Il a ensuite atteint les cadres possesseurs de l’appareil, cadres et techniciens absorbés dans le système qu’ils géraient ; envahi enfin les professions libérales qui s’en croyaient protégées, et les belles âmes littéraires ou artistiques. Dans ses eaux, il roule et disperse les œuvres, jadis insulaires, muées aujourd’hui en gouttes d’eau dans la mer, ou en métaphores d’une dissémination langagière qui n’a plus d’auteur, mais devient le discours ou la citation indéfinie de l’autre.
– Michel de CERTEAU 1
Pour Jean-Marc
Depuis quelques temps une question en apparence anodine me poursuit : pourquoi avoir un site Internet ?
Soyons plus précis. Dans cette question, le verbe « avoir » est tendancieux : la terminologie en usage, qui veut qu’on « ait » un site et qu’on soit « propriétaire » de son nom de domaine, est de mon point de vue trompeuse. Pour peu que je le comprenne, du moins dans la majorité des cas, on n’« a » pas un site Internet. On paie, par une sorte de contrat qui me semble relever davantage de la location que de la propriété, le droit de demander à l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) 2, via une autorité de régulation nationale, que l’utilisateur, tapant dans un navigateur le nom de domaine que nous avons enregistré, soit renvoyé vers l’adresse unique du serveur où notre site est hébergé. Certes, tant qu’on continue de payer, nul autre que nous ne peut jouir de ce droit. Et notre autorisation est nécessaire pour le céder à un tiers. Mais si l’on cesse de payer, le nom de domaine en question redevient disponible à la location. Pareil pour notre hébergement, le plus souvent loué chez un prestataire spécialisé, qui le rendrait inaccessible en cas de cessation de paiement, puis l’effacerait sans tarder. Ce préalable pour rappeler que ce qui suit concerne des réalités certes tangibles mais volatiles. En outre elles sont dépendantes de facteurs politiques sur lesquels le citoyen a peu de prise, comme le montre l’histoire de la genèse de l’ICANN, que rapporte l’encyclopédie en ligne Wikipédia 3. Autrement dit, un site Internet est un agrégat de dispositifs physiques, convergeant vers un service organisé par l’argent et soumis à la géopolitique, dont il me semble un peu naïf de se revendiquer propriétaire et de s’y sentir chez soi.
Cela étant dit, voilà bientôt vingt ans que sous des formes successives le présent site existe, attendu que j’en loue les moyens d’existence. Et au moins la moitié que je ne me demande plus pourquoi, ni même à quoi il sert. Il est temps.
Ma question est envisagée non dans une portée absolue mais bêtement circonscrite à ma situation professionnelle : photographe-auteur exerçant simultanément diverses activités éditoriales, pédagogiques, académiques et littéraires, pourquoi avoir, et en l’occurrence pourquoi garder un site Internet ? La question me poursuit car chaque fois que j’estime y avoir apporté une réponse satisfaisante, elle esquive, rebondit dans les angles, se diffracte et m’échappe. J’aimerais tenter ici de l’apprivoiser et ce faisant, de dégager si possible des arguments un peu stables qui m’aideront à décider ce que ce site doit devenir. J’espère que le lecteur concerné par une question similaire, quel que soit son champ d’activité, trouvera dans cette tentative un intérêt.
*
Longtemps la question ne s’est pas posée ou ne recevait que des réponses triviales. J’ai eu mon premier site parce que c’était tentant et que c’était possible. Ce qui ne sont pas nécessairement des raisons louables. C’était vers 2002, peu avant mon entrée à l’Agence VU’, un an après notre arrivée en France. Nous avions emménagé aux Pilles, dans le sud de la Drôme. Au village siégeait Africultures, une association éditant une revue dédiée aux cultures africaines. Africultures avait alors entrepris de se doter d’un site Internet et avait rassemblé pour ce faire, au dernier étage d’une maison face à l’église et dos à la rivière, une petite équipe qu’elle cherchait à étoffer d’une sorte d’homme à tout faire. Ce fut mon premier vrai travail en France. (Auparavant il y en eut un faux : pendant l’été 2001 j’ai sillonné les Baronnies à la recherche des abonnés du téléphone pour leur livrer leurs annuaires, sbire d’un éphémère métier alors déjà ravi aux facteurs, et dont aujourd’hui toutes les modalités ont disparu).
À l’époque on accédait à Internet par ligne commutée, à un débit de cinquante-six mille octets par seconde, sur des écrans cathodiques de dix-sept pouces de diagonale qui laissaient sur nos tables de travail juste assez de place pour une souris à boule et un clavier. La connexion était facturée à la minute. Avoir un site était une pratique qui commençait à se répandre parmi les photographes. Comme en tant d’autres domaines naissait là une extension de notre champ professionnel. Extension encore mal définie, peu codifiée, appréhendée de façon tantôt bancale, tantôt naïve, tantôt ostentatoire. Mais d’emblée exerçant l’attirance de la nouveauté, attirance accrue par la fable de la dématérialisation. Nous découvrions qu’il était possible et apparemment sans effort d’occuper un petit lopin à nous sur ces terres vierges, où il serait tenu sur nous le discours que nous fabriquerions, instantanément et en permanence accessible à tous. Au passage toute une génération de photographes se confrontèrent à l’exercice d’équilibre narcissique consistant à écrire sa propre biographie à la troisième personne du singulier. Une façon d’exister sans être là, de se rendre visible en l’absence d’un corps. Un lieu où faire voir des images, ou des approximations d’images, sans devoir parcourir le pays de galerie en rédaction. Et, pour peu que le site fût bilingue, de les faire voir bien au-delà. Rendre visible, faire voir : deux préoccupations du photographe – l’une s’en remettant au hasard, l’autre répondant à une sollicitation –, qui recevaient par ce biais une solution irrésistible. En bref, nous découvrions le déplacement de notre activité vers sa mise en scène – autrement dit, la propagande personnelle. Pour beaucoup, de possible, y être devint vite perçu comme indispensable.
Ce lopin, si l’on put nourrir l’illusion que l’occuper se faisait sans effort (j’y reviendrai), s’en occuper était et reste une activité technique, concrète, laborieuse, et tout ce qu’il y a de moins dématérialisée (j’y reviendrai aussi). La distinction que je vois entre les deux concerne le rapport à la passivité : occuper ce lopin consiste simplement à y stocker des données sous forme d’un site, alors que s’en occuper signifie le rendre et le maintenir trouvable et consultable.
Au premier chef alors, y bâtir un site requérait qu’un humain connaissant le langage HTML 4 consacrât une somme d’heures bien réelles à en coder les pages. Je ne le connaissais pas. Jean-Marc, l’informaticien d’Africultures, c’était son métier. Il voulut bien. Au début, il me construisit un site élémentaire composé de quelques pages statiques. Y étaient présentées Katmandou 2058, la série népalaise avec laquelle Christian Caujolle m’accepterait bientôt à l’agence VU’, et l’actualité y afférente. En capacité de « montrer mon travail » de Paris à New-York et de Bruxelles à Katmandou, j’y pris goût. (Je ne trouvais pas encore étrange de nommer « montrer son travail » le fait de mettre en ligne des collections de pixels compressés dont nul ne savait dans quelles conditions de qualité elles seraient regardées.) Ainsi, mes « besoins » évoluèrent. C’est-à-dire que de cette facilité naquirent des envies que je ne fus pas long à nommer besoins 5. De nouvelles images s’ajoutèrent au rythme de mes séjours au Népal. Le nombre de pages augmentait en fonction. Jean-Marc maîtrisait aussi le langage ASP 6 et bientôt mon site devint dynamique, affichant ses contenus depuis une base de donnée administrée par des formulaires de son invention. Puis il préféra le PHP 7 et transforma mon site en PHP. Plus tard le CSS 8 devint la norme graphique d’affichage des sites Internet, et donc du mien. Tout cela, en échange de bois de chauffage, de cartons de vin, d’un tirage photographique, d’un casier de Chimay ramené de Belgique, le plus souvent de rien, par amitié, par générosité. En dehors de ces transformations je me débrouillais. La notion de mise à jour m’était inconnue, pas plus que celle de piratage. Une fois l’an je payais mon nom de domaine et mon hébergement. Une cinquantaine d’euros. Montant indéchiffrable, non en tant que tel, mais pour ce qu’il a d’arbitraire. Je sais ce que représentent cinquante euros par exemple en kilos de riz, ou en heures de travail, les miennes comme de celles de mon garagiste. Mais ici, pourquoi davantage cinquante que dix ou mille ? Quel est le rapport entre le coût des infrastructures étayant ces services et le prix demandé pour leur utilisation ? Je ne cherchais pas à comprendre. Cinquante était à ma portée. Je payais. Cela mis à part, cet outil de mon activité existait par lui-même, c’est-à-dire surtout par l’intelligence de sa conception. J’en sus à Jean-Marc un gré quotidien. Cette relative insouciance dura dix ans.
*
Au cours de cette décennie, la plupart des métiers qui rendaient possible celui de photographe subirent un transfert de compétence graduel, mais massif et forcé, vers les photographes eux-mêmes. Avec des nuances d’un photographe à l’autre – notamment pour les membres d’agences et de collectifs –, nombre d’entre nous allaient répondre favorablement à l’injonction d’autonomie que ce transfert impliquait. Nous allions apprendre à nous occuper de tâches aussi diverses que notre communication, le développement de nos fichiers, la calibration de notre chaîne graphique, notre diffusion, notre auto-édition, nos vidéos, leur montage et leurs effets spéciaux, nos tirages en encres pigmentaires, la maintenance de notre ordinateur, sans oublier de tenir aiguisé notre regard sur le monde et d’apprendre à en transmettre l’essence avec pédagogie. La seule activité que nous n’avons pas été capables de faire nous-mêmes, et pour cause, c’est de publier nos photographies dans les journaux. Comme les journaux ne tardèrent pas à montrer qu’eux non plus n’en étaient plus capables, nous avons appris à nous publier ailleurs. Et de tout cela, nous avons appris le vocabulaire, les techniques, les logiciels et les outils – et qu’ils se renouvellent toujours plus vite, que leur puissance et leurs capacités augmentent en fonction, et qu’il faut apprendre à suivre. Un jour, nous nous aviserions que l’horizon d’une telle autonomisation s’appelle l’autarcie, et que l’autarcie c’est la négation de l’autre, donc de la vie. Mais ce serait pour plus tard. Pour l’heure, puisque telle était la voie pour exister photographe, et puisque cette existence primait sur toute autre considération, nous consentions.
Dans ces conditions, quoi de plus normal que d’apprendre à faire également soi-même son site ? Je m’en croyais à l’abri. J’avais tort. Des questions apparurent de nature et d’ampleur nouvelles. Plus juste une fonction obsolète à remplacer, ou une astuce à trouver pour mettre en place une idée. Des problèmes de fond. C’est désormais souvent sur des téléphones que les sites étaient consultés. Or la plupart n’avaient pas été prévus pour des écrans aussi petits. Il fallait les adapter pour que leurs contenus s’affichent différemment en fonction de la taille de l’écran de l’ordinateur, du téléphone ou de la tablette. C’était un travail long. De plus, il y avait à présent tellement de sites qu’être vu cessa de relever ni du hasard, ni de la richesse d’une sorte de page aujourd’hui oubliée – celles des « liens » vers les sites amis. C’était l’époque où l’on cherchait à gonfler son « PageRank » afin d’être trouvé avant les autres. J’étais mal placé. Quand on tapait « photo Népal » dans un (dans le) moteur de recherche, mon site n’apparaissait pas avant des dizaines de pages. Une partie de ma raison s’étonnait que de tels sujets fussent devenus des problèmes de mon métier – photographe, pour rappel. Une autre se disait qu’y apporter une réponse était toujours une possibilité que surgisse un moyen de remplir le frigo.
Ainsi, pour que mon site continuât d’être trouvable et consultable par le plus grand nombre, il y avait à nouveau du travail à fournir. Mais cette fois c’était un travail que je n’avais pas choisi, qui ne me faisait pas plaisir, ne correspondait à aucune envie d’amélioration des fonctionnalités imaginées avec Jean-Marc, ni à aucun éventuel nouveau besoin lié à mon souhait d’être présent sur Internet. Si dix ans plus tôt avoir un site était « possible et tentant », le garder impliquait désormais des transformations pénibles et obligatoires, imposées en quelque sorte de l’extérieur, par l’évolution des usages de l’outil choisi pour répondre à un souhait qui, lui, n’avait pas changé. Le travail accompli, je n’en tirerais aucune satisfaction nouvelle. Le lecteur, guère plus. Mon site apparaîtrait un peu plus haut dans les résultats de recherche. Celui qui le consulte sur son téléphone trouverait désormais un contenu adapté à son écran sans devoir attendre de s’asseoir à un ordinateur. Mais c’est à peu près tout.
Bref, comme il faut changer la courroie de transmission d’un moteur, j’étais en train d’apprendre qu’un site également s’entretient, et que ne pas en avoir est le seul moyen d’échapper à cette corvée. À ceci près que la courroie s’use avec le temps. Il faut la remplacer avant qu’elle ne casse et que, privés de synchronisation, les pistons ne se fracassent contre les soupapes. Sur Internet, aucune partie d’aucun site ne s’érode du seul fait de son usage. Il y a bien quelques mémoires caches à vider, mais ce n’est pas à proprement parler de l’usure. C’est plutôt le cadre dans lequel le site est utilisé qui évolue. Pour continuer de filer cette métaphore automobile, ce serait plutôt comme si on avait remplacé les routes par d’autres types de voies où la circulation des véhicules à roues chaussées de pneus serait rendue d’abord malaisée et ensuite impossible, pour la seule raison qu’une autre sorte de véhicules fût apparue. Mais bon, une sorte d’entretien quand même, quoique adventice, et en réalité, infini. Et comme ça, insensiblement, d’un modeste outil rendant un service de façon presque « conviviale » – Ivan Illich eût sans doute récusé ce recours à son concept dans un champ qui l’est si peu 9 –, avoir un site était devenu une tâche exigeant du temps, potentiellement davantage de temps que le temps qu’il faisait gagner. Or sans site, cette obligation d’évolution était automatiquement frappée d’extinction. À cause de ce site au contraire naissait une nécessité, hors de ce contexte parfaitement absurde. C’est la première fois que j’ai questionné la pertinence de garder le mien.
Or donc, s’adapter ou non ? Si j’avais beaucoup appris avec Jean-Marc et parvenais à lire et comprendre le PHP ou le CSS, je n’étais toujours pas capable de les écrire. Les développements à entreprendre me semblaient à la fois lourds et hors de ma porté. Quant à stimuler son PageRank, qui n’est pas affaire de technique mais d’esprit commercial… bonté divine, je m’égare, le lecteur me pardonne cet écart de langage et l’abandon de cette phrase en l’état. Entretemps Jean-Marc et moi avions cessé de travailler pour Africultures. Son propre rapport au code avait changé. Il en avait trop fait, de trop longues nuits, le code continuant de tourner dans la tête pendant de trop longues insomnies. Lorsque nous nous voyions c’était plus pour l’amitié que pour le boulot. J’ai temporisé.
*
À l’été 2014, me voyant bricoler un peu dans ce cambouis, mes éditeurs me proposèrent de repenser le site du Bec en l’air, dont la vieille mouture n’échappait pas à l’obsolescence générale. Y manquaient de plus une boutique, un agenda, de la vidéo, etc. Dans un premier temps je leur répondis selon la logique apprise auprès de Jean-Marc : analyser des attentes, définir des fonctionnalités, organiser des principes de circulation entre elles, concevoir la base de données correspondante et programmer les pages destinées à l’interroger (en l’occurrence, les faire programmer). Je me trompais. En dix ans une autre évolution s’était produite, que je n’avais pas vue, contrairement à mes amis : le système de gestion de contenus (Content Management System, ou CMS) WordPress 10 était devenu inévitable. Il permettait à chacun de créer un site très complet a priori sans connaître aucun langage informatique. Les notions de cœur, de thème et d’extension 11 me devinrent familières.
Le site fut publié en septembre. Avec satisfaction et profit, et pourtant, sur un malentendu. Je n’ai pas vu le changement de philosophie d’avec l’école à laquelle j’avais été tant soit peu « formé » par Jean-Marc. Ou si je l’ai vu, je n’en ai pas compris la portée. Or ce sont deux mondes opposés. WordPress n’est pas fait pour répondre à un besoin, mais à tous les besoins. Avec un seul outil, chacun doit pouvoir bâtir toutes espèces de sites, du blog le plus simple à la boutique la plus sophistiquée. De sorte que WordPress est beaucoup plus large et puissant que nécessaire pour la plupart de ses usagers. Ce qui a des implications multiples, par exemple sur la quantité de données stockées et transférées, que je ne comprendrais que plus tard et sur lesquelles je reviendrai plus loin. Et malgré tout il n’est jamais assez large. Les besoins du plus grand nombre étant potentiellement infinis, même les meilleurs informaticiens ne peuvent les prévoir tous en une fois. C’est pourquoi WordPress est condamné à croître et à se renouveler, ses thèmes et extensions à devenir obsolètes et être remplacés par d’autres, indéfiniment. Ce qui a également des implications que je ne tarderais pas à découvrir. En attendant tout cela m’avait parfaitement échappé. Ainsi ai-je pensé le nouveau site du Bec en l’air comme un site de naguère. Une bulle autonome, à la structure figée, créée pour répondre à la demande d’un commanditaire unique, et qui fonctionnerait tant que les navigateurs voudraient bien transposer les langages dans lesquels il était écrit en un affichage cohérent. Par quelle méprise ? Par ignorance, par empressement – ou par habitude, tant les opérations d’ajout de contenus à la base de données via des formulaires d’administration étaient similaires à celles que j’avais pratiquées jusque-là. Opérations que nous allions reproduire sur ce nouveau site, mes éditeurs et moi, presque quotidiennement. Mais pour le reste, du jour de sa mise en ligne à celui de sa disparition, je n’ai effectué aucune mise à jour d’aucune de ses composantes. Et comme tout fonctionnait, nous ne nous sommes jamais inquiétés de rien. Cette cécité n’eut d’abord et pour quelques années aucune conséquence.
*
Entretemps j’avais commencé d’écrire des textes sur la photographie, pour moi et pour d’autres. Je me voyais bien les partager sur mon site. Il n’était pas prévu pour, puisque jusque-là le cas ne s’était pas présenté. Alors à mon tour j’ai installé WordPress, acheté un thème déjà traduit en français qui s’appelait Galopin, et ouvert un petit blog que j’ai nommé Aux Bords du cadre, inspiré par une émission radiophonique où Jean-Louis Comolli avait si bien établi les enjeux de ce qui se passe à la périphérie d’une image 12. Ce blog était graphiquement sans prétention, ne dura pas longtemps, ne fut lu par personne, mais j’avais fait le pas.
Puis vint le tremblement de terre au Népal, le 25 avril 2015. En cinquante-deux secondes la Terre transfusa vers son centre l’essentiel de mon énergie via la plante de mes pieds. Pendant les six mois suivants, le peu qui m’en restait fut consacré à retrouver des forces, et pour cette simple tâche fut largement insuffisant. La tête au milieu des ruines, les questions posées par la nécessité de faire évoluer mon site et de le rendre adaptatif aux téléphones et tablettes étaient non seulement insurmontables mais indécentes. N’étant guère tourné vers autrui à cette époque où je cherchais d’abord à retrouver un horizon, les autres n’étaient guère tournés vers moi non plus. Rien ne positif n’en émanant plus, avoir un site était devenu un fardeau. J’étais prêt à le supprimer. Mon éditrice m’en dissuada. « Garde quand même une présence minimale », me conseilla Fabienne. J’ai obtempéré. À l’été 2015, j’ai recréé mon site sous WordPress, en version abrégée. J’ai choisi un thème plutôt bien pensé, Lens, édité par une équipe roumaine, et qui permettait de présenter quelques images et un blog dans un langage graphique élégant pour l’époque. Au début je ne montrais que trois séries : Brumes à venir, l’Usure du Monde et Épiphanies du Quotidien, mes textes et une biographie. Les téléphones l’affichaient. Ça faisait le job, comme on dit. J’ai supprimé définitivement le vieux site de Jean-Marc. Je ne sais même pas si on a trinqué à cela. Il faudra, un jour. Et je me suis cru tiré d’affaire.
Je n’avais toujours pas compris qu’être en ligne est un travail, et que WordPress, loin de le simplifier, ne fait que l’alourdir. Car WordPress est ainsi conçu qu’il incite l’utilisateur à croître en proportion. Comme le thème était compatible avec le multilinguisme j’ai traduit mon site en anglais ; compatible aussi avec les extensions de commerce en ligne, eh bien j’ai mis en place une boutique de vente de tirages. Et tant qu’à faire, dans un élan désuet à l’époque où Facebook était devenu l’agenda d’un quart des humains, j’ai recréé un agenda. Et bien sûr j’ai ajouté d’autres séries d’images et, à mon retour du Qatar, des vidéos. Puis j’ai recommencé la traduction du site, car l’extension initialement choisie fonctionnait mal, et je n’avais pas vu que les concepteurs du thème en préconisaient une autre – mais payante, mais pas chère, donc j’ai payé, mais plus tard ce qui était offert pour le prix de départ changea de définition, si bien qu’il fut logique de repayer encore. Cependant mon blog s’est développé avec les traductions de Jörg Colberg, la page bimensuelle dans Trek Mag, les entretiens, les textes critiques, le journal de résidence à Nottingham… Et toujours – à croire que je n’avais pas tant que cela envie de quitter Internet – cette grande question d’être vu. La solution existe, évidemment, et porte un nom, l’ « optimisation pour les moteurs de recherche » 13, que l’utilisateur de WordPress ne peut ignorer depuis qu’existe une extension pour optimiser cette optimisation. Dans un mouvement très « bon élève », je l’ai installée et paramétrée. Il existe aussi des outils pour envoyer des lettres d’information. C’est pratique, une lettre d’information, pour tenir au courant nos abonnés de ce que nous faisons. Nous en avons une au Bec en l’air. Je n’ai pas d’abonnés, mais j’ai fait des essais moi aussi – non concluants, je n’ai jamais envoyée la première, pour des raisons que j’ai développées dans « le bruit de fond anonyme du monde » 14. J’en suis resté au RSS 15. Mais j’ai peut-être tort. L’autre jour, je disais à une amie que j’avais publié mon journal de résidence à Aubenas 16 sur mon blog. Sa première réaction a réveillé ces doutes : « ah bon ? pourtant je n’ai pas reçu l’e-mail ! ». « Tu n’as pas reçu l’e-mail parce que je n’en ai pas envoyé », ai-je bien dû lui dire. Et en manière de fausse boutade, j’ai ajouté : « c’est le principe de ce blog : exister pour n’être lu que par hasard ». Et dans la foulée je me suis dit que ce ne serait pas bête de faire les mises à jour de ce magma d’octets. Je ne sais au juste ce qui m’y a poussé. Peut-être la curiosité empirique, pour avoir un point de comparaison avec le site du Bec en l’air où je ne les faisais pas. Mais ce n’est pas anodin, mettre à jour. D’abord, c’est acquiescer à l’une des injonctions les plus débilitantes de la post-modernité où il faut toujours être à jour de tout, tout le temps et partout, dans toutes sortes d’ « espaces personnels » en ligne où par une sorte d’allégorie cynique, nous devrions nous sentir chez nous. Et puis, au plan technique, dans une structure où toutes les composantes fonctionnent en synergie, il n’est jamais certain que la mise à jour de l’une ne provoque pas une panne de l’autre. Raison pour laquelle j’ai parfois dû revenir sur certains de mes choix. J’ai supprimé cette boutique, par exemple, lorsqu’une mise à jour « obligatoire » d’un élément avait provoqué des dysfonctionnements d’ensemble, trop longs à comprendre et à corriger.
Mais bon, mon site était présentable, lisible sur tous terminaux, prenait de l’épaisseur, et peut-être devenait-il un peu plus que le miroir d’une activité professionnelle : le lieu d’une parole. Tout cela réalisé seul, en apparence. Comme ne pas y voir une forme de liberté ? Certes pas « la » liberté. Un site n’est jamais qu’un site. Mais un sous-ensemble de liberté, relative et restreinte à ce contexte où j’assume la contrainte inhérente à ma volonté de communiquer sur mon activité professionnelle, et qui fluidifie cette contrainte. Liberté qui a un prix, évidemment, mesurable en temps d’ordinateur passé à acquérir des compétences qui en dehors de ce contexte ne m’intéressent pas. Mais toute liberté a un prix. L’idée que la liberté se paie de renoncements ne me semble pas choquante et est même une garantie que c’est bien de liberté dont il s’agit. Et si le mot « liberté » est trop fort, disons une marge de manœuvre, ou une autonomie. Mais en l’espèce ce n’était qu’une illusion d’autonomie. Car les solutions annoncées comme toutes prêtes et ne requérant aucune connaissance ne le sont jamais. Au lieu d’un coup de fil à Jean-Marc quand un problème résistait, ou chaque fois qu’il y avait à régler quelque incohérence ou incompatibilité, c’étaient des heures de recherches et de messages sur des forums, où d’ailleurs le plus souvent l’entraide est bienveillante et efficace, il faut le signaler. Ça occupe, c’est certain. Une sorte d’animal de compagnie si l’on veut, du genre pachyderme. Je m’ennuyais, tiens, ça tombe bien cette espèce de tamagotchi à entretenir, alimenter, dépanner, et qui vieillit, et mal, et comme si cela ne suffisait pas, offre prise à toutes sortes d’attaques.
Le 16 décembre 2018, le site du Bec en l’air fut piraté. Pas un petit piratage dont on se sort en revenant à la sauvegarde de la veille. Une infection durable de la base de données, injectée via une porte dérobée rendue accessible, on l’aura compris, par un défaut de mise à jour d’une extension. Ce n’est pas le lieu de raconter ici les jours et les nuits d’efforts consacrés à le remettre en ligne. Disons simplement que je n’y suis pas parvenu, et qu’en mars 2019, c’est un site neuf alimenté par une base de données neuve que j’ai publié. Cette fois j’ai compris la leçon, je mettrai à jour. Avec pour conséquence la découverte de deux nouveaux besoins : une extension de protection du site, et une extension de sauvegarde efficace de la base de données.
Et bien sûr, au regard des semaines d’affolement et d’insomnies passés à tenter de comprendre ce qui s’était produit et comment le réparer, je me suis demandé si pareillement je ne devais pas protéger mon propre site. L’extension de sécurité choisie pour le Bec en l’air m’envoie un courriel dès qu’une composante du site nécessite une mise à jour, c’est-à-dire plusieurs fois par semaine. À quoi s’ajoute un bilan d’activité hebdomadaire détaillant les dizaines de tentatives de connexions frauduleuses et d’injections de code malveillant dans la base de données. Vue la charge mentale que représente ce vertige de messages d’alertes, je me suis abstenu de la multiplier. Ne tenant pas à ce que les vulnérabilités de mon propre site me soient notifiées quotidiennement par courriel, je n’ai pas installé l’extension, et j’ai gentiment continué d’en mettre à jour les composantes et d’en conserver des sauvegardes utilisables.
Jusqu’à cet automne, où l’obsolescence, ce vieil hibou insolent, est une nouvelle fois venue me rappeler sa loi. Après une mise à jour de WordPress mon site a cessé de fonctionner correctement. En revenant à la version antérieure de WordPress j’en ai rétabli le comportement normal. Mais pendant quelques temps, impossible de télécharger une mise à jour du thème corrigeant ce défaut. Ça commençait à faire beaucoup. Car ce thème est à présent si vieux qu’il est fort possible que demain il ne soit plus mis à jour du tout. Au plan graphique en outre, on peut être fondé à juger qu’il commence à accuser son âge et à faire très 2015, comme on disait en 2017. On peut sans doute imaginer plus sobre. Sans compter qu’elles sont pléthore, les firmes spécialisées dans WordPress qui mettent des thèmes sur le marché puis la clef sous la porte sans prévenir, laissant dans la jungle d’Internet des milliers de thèmes sans suivi. Au vrai, je me suis vu faire et attendre des mises à jour WordPress pendant les vingt ou trente années à venir, avec une incidence sur mon temps de liberté loin d’être insignifiante. J’ai pris peur. Et je me suis avisé qu’en cinq ans, avec une bonne volonté conspirant à l’abnégation, j’avais fabriqué tout seul une petite situation inextricable où je me retrouve enchaîné à un pachyderme, certes aimable mais cachectique et probablement, à moyen terme au mieux, condamné. Avec le choix suivant : l’envoyer sur le champ à l’équarrissage, le laisser se fossiliser, ou lui consacrer davantage de temps, ce qui finira tôt ou tard par ressembler à des soins palliatifs. Alternativement se profile l’idée de repartir à zéro. La mise à jour de mon thème a été publiée mi-janvier 2020. Trop tard. Entretemps la machine à questions s’est emballée, abolissant la possibilité d’un rapport serein à l’outil actuel de ma présence en ligne.
*
Alors repartir à zéro ? Pourquoi pas, mais cela vaut bien quelques questions préalables. Et deux conditions : réduire la dépendance au potentiel futur outil de cette présence, et injecter dans l’équation un paramètre que, tout engourdi par la promesse de WordPress de satisfaire mes besoins, j’ai fait semblant d’ignorer pendant trop longtemps : l’hypertrophie de ce système.
Prenons alors un peu d’altitude et tentons de dégager de l’expérience une sorte de bilan prospectif afin de voir si un tel projet est réaliste.
Quitte à tout repenser, commençons par la nécessité elle-même d’avoir un site. Ce n’en est pas une pour tous les photographes. J’ai travaillé récemment au Bec en l’air sur le catalogue des acquisitions photographiques des institutions publiques françaises, où l’on constate que si au début et jusqu’en milieu de carrière beaucoup de photographes ont un site, à un certain niveau de reconnaissance il est courant de n’en avoir pas. Peu connus des amateurs de photographie mais habitués du monde de l’art contemporain, nombre d’artistes n’existent en ligne que sur les sites des galeries qui les représentent ou des institutions qui les achètent. Ils délèguent. Ce qu’ils font du temps ainsi gagné, j’aimerais le savoir. J’espère pour eux : avoir l’esprit tranquille pour créer. Et puis tout en haut de l’échelle, pas de règle, dirait-on. Certaines stars n’en ont pas (Thomas Ruff), d’autres bien (Thomas Struth, Stephen Shore). Gageons qu’ils ne s’en occupent pas eux-mêmes. Notons enfin que si l’on a eu un site à une époque rien n’empêche d’y renoncer plus tard, que ce soit en réaction à l’évolution d’Internet, de notre situation professionnelle ou de ce qu’on a envie de dire publiquement.
Pour ma part, ai-je toujours besoin ou envie d’un site ?
Si oui, pour dire quoi ? Pour dire que je raconte une histoire par l’écriture et la photographie. En gardant à l’esprit que le site n’est pas le lieu de l’histoire : il n’est qu’un lieu où dire que l’écriture de l’histoire est en cours. Le dire à qui ? Au lecteur qui arrive jusque-là, que l’histoire touche, et qui trouvera sur le site le moyen de la lire ou l’écouter là où elle se produit : dans les livres, les projections, les rencontres, les activités pédagogiques.
Comment le site fait-il cela ? Par quelques pages dédiées aux chapitres achevés de l’histoire : une dizaine d’images, un extrait de texte, la couverture d’un livre et les informations permettant de se le procurer. Lorsque j’entame un nouveau chapitre je lui ouvre une nouvelle page qui n’évoluera quasi plus. Plus rarement encore j’ajoute un détail à mon curriculum. L’essentiel est donc figé. Outre la page d’actualité, ce qui évolue est le blog, à toute petite allure, deux ou trois textes par an, un peu plus les années de résidence où j’écris un journal. De nouveaux chapitres photographiques, je n’en vois pas venir. Quant à l’écriture, je me vois bien en revanche l’explorer encore un peu.
Le lecteur arrive-t-il jusque-là et comment ? Ayant de partout fermé les écoutilles et colmaté les points d’infiltration de ce site, refusant de surcroît la pratique du méta-langage consistant à faire savoir par tous les canaux possibles qu’un nouveau texte est en ligne, je n’en ai aucune idée. Parions qu’il existe des extensions WordPress pour le savoir, mais je préfère ne pas. La joie et l’étonnement me plaisent et me suffisent, qui surviennent lorsqu’un lecteur prend le temps de m’écrire. Au reste, ce site n’est pas rétif à la sérendipité, mais il n’est ni pensé ni accompagné pour la favoriser. Les probabilités que quelqu’un saisisse la bonne série de mots-clefs pour l’atteindre sont infimes. Ainsi pris dans le flux sans la bouée de la communication sociale-réticulaire, on peut supposer que son lectorat est assez faible et ne croît que par un discret bouche-à-oreille. (Au printemps 2019 j’ai fait cette expérience : j’ai mis mon site hors ligne sans esprit de rétablissement, à la fois par lassitude et pour voir ce que cela produirait. L’ami Mathias à l’agence VU’ s’en est inquiété au bout de quinze jours. Assez rapide, en vérité. Il y a donc quelqu’un qui suit.) S’il est avéré enfin que ce site a permis à plusieurs personnes de se faire une idée de ma pratique avant de me solliciter professionnellement, à ma connaissance nul ne m’a jamais proposé un travail pour avoir découvert mon site par hasard.
N’était donc ce blog, ce site est resté ce qu’il était au début : une carte de visite améliorée en somme. Je ne l’envoie pas, mais j’y renvoie les personnes que je crois devoir informer de mon activité. C’est un outil de confirmation ou non de ce qu’elles ont pressenti avant de venir. Usage finalement assez modeste. Cela étant, doit-il continuer d’exister ? Le blog, le site, ou les deux ?
Au vrai, je me suis attaché à ce blog. Pas à sa forme, elle m’importe peu, mais à son lieu. Depuis le temps que je me demande s’il ne vaudrait pas mieux se taire dès lors que tout message est devenu inaudible dans le flux, le geste de continuer à alimenter ce lieu finit d’ailleurs par ressembler à une sorte de réponse à la question. À défaut d’une revue où publier, j’aurais du mal à me priver de cet espace où je puis « librement » rendre disponible une certaine parole sur la photographie en marge du temps long des livres. Cette liberté est pourtant sujette à caution. Sans le garde-fou d’un éditeur, ces textes ont-ils la légitimité qu’ils pourraient ou devraient avoir ? Un bon éditeur, je suis bien placé pour le savoir, est quelqu’un qui aide l’auteur à tenir son histoire et lui évite d’avoir « a wheel in the ditch and a wheel on the track » 17. Fonction qui prolonge en quelque sorte celle du titre, telle que je l’ai rappelée dans le journal d’Aubenas 18. Édité par soi-même, c’est de nouveau l’autarcie. Bien sûr, un éditeur parfois se trompe, parfois tarde à comprendre. L’histoire de la littérature abonde d’exemples en ce sens. Mais il ne s’agit pas de réclamer une tutelle ou une béquille. Simplement, à l’humble échelle des réflexions menées ici depuis quelques années, il y a des fois où je me dis qu’un regard extérieur avant de mettre un texte en ligne pourrait s’avérer bénéfique. Car je ne vois peut-être pas que je m’enferme, ou que je divague, où que je tourne en rond. Je pense souvent à cette réplique de ce critique d’art mondain qui fait et défait les carrières dans La Grande bellezza de Paolo Sorentino, je cite de mémoire : « je n’avais peut-être pas tant de choses à dire que ça » 19. On peut ainsi certainement débattre de la pertinence de la parole dont ce site rend compte, et arguer de ce qu’un sursaut artistique ou conceptuel de ma part attirerait davantage de public vers ces parages et générerait davantage de retombées. C’est fort possible. Laissons toutefois l’hypothèse d’une telle critique à autrui et en attendant, même si nul ne se relève la nuit pour le lire, admettons que ce qui se dit ici l’est avec honnêteté.
Quant au reste du site, voici. J’ai 47 ans. N’ayant presque jamais occupé d’emploi salarié, ne cotisant comme auteur que depuis 2018, je n’aurai pas de retraite, ou alors juste de quoi payer les notes d’électricité. Sauf à changer promptement de métier et à le faire avec stratégie, je ne peux dès lors qu’imaginer travailler jusqu’à la dernière minute. À moins que survienne une forme de reconnaissance à la faveur de laquelle mes tirages se vendraient sans moi par le truchement d’un agent, pendant que je lirais les livres gardés en réserve et me promènerais dans la colline. Mais par prudence, escomptons plutôt travailler. Dans un cas comme dans l’autre, maintenir visitable cette carte de visite augmentée quelques temps encore me semble et jusqu’à preuve du contraire raisonnable.
*
En énergie et en temps, la preuve du contraire est établie ci-dessus. Sous sa forme actuelle, le rapport entre ce que ce site permet et ce qu’il coûte est parfaitement déraisonnable. La technique évoluant, ce rapport ne va pas s’améliorer. Étant entendu ce qui précède quant à son contenu éditorial, mettons résolument cette balance négative sur le compte de l’incessant changement d’état de l’outil obligeant son usager à se réadapter. Ce déficit peut-il être rééquilibré ?
Financièrement, il y a peu de marge d’amélioration. J’ai mentionné plus haut le coût de l’hébergement. Des solutions gratuites existent certainement, sans doute assorties de contraintes que je ne connais pas, mais si l’on choisit de payer, ce coût est sensiblement pareil d’un opérateur à l’autre. À cinquante euros par an, sur disons quarante ans cela fait quelques heures de travail, mais supposons que le jeu en vaille la chandelle. Du point de vue strictement pécuniaire WordPress est gratuit. Un thème bien conçu coûte une soixantaine d’euros une fois pour toutes. Si des thèmes gratuits existent aussi, peu sont édités et entretenus sérieusement. Certaines extensions sont payantes ou proposent des versions payantes, mais pour l’usage d’un travailleur indépendant individuel, il est rare que les fonctionnalités ouvertes par les « formules premium » justifient de s’y abonner. Seule l’extension de traduction choisie pour des raisons de compatibilité avec mon thème est payante, mais des extensions de ce type existent aussi en version gratuite. En bref, avoir un site sous WordPress peut ne rien coûter que les frais éventuels de son hébergement et de la location d’un nom de domaine. L’on gardera néanmoins à l’esprit que ce qui n’est pas payé en monnaie fiduciaire l’est toujours autrement.
Reste le critère, attention au gros mot, environnemental. J’ai dit au début de ce texte que ce « petit lopin à nous », « l’occuper », c’est-à-dire avoir les données de notre site stockées sur un serveur, se faisait « apparemment sans effort » : sans effort pour nous, peut-être, mais certes pas pour la collectivité. Ces efforts sont-ils raisonnables ? Voire. Ce serveur, installé dans un centre de données quelque part sur la planète, reste allumé en permanence pour en garantir l’accès à toute heure et sous tous fuseaux. Que cela consomme de l’énergie, nul ne songerait à le nier (encore que). Mais nous ne voyons souvent ces choses-là qu’à l’échelle de nos propres usages et équipements. Nous avons du mal à nous figurer ce que représente cette consommation une fois multipliée par des millions d’ordinateurs et de serveurs à travers le monde. Le lecteur a certainement entendu des analogies de ce type : envoyer un courriel accompagné d’une pièce jointe d’un mégaoctet consomme autant d’énergie qu’une ampoule de soixante watts allumée pendant vingt-cinq minutes. Est-ce vrai ou non ? Cela dépend certainement de beaucoup de facteurs difficiles à prendre en compte avec précision, mais l’analogie est frappante. Si l’on se met à considérer la quantité de courriels que nous envoyons en une journée, elle devient vertigineuse. Le 17 octobre 2018 à la radio, dans La Méthode scientifique, Nicolas Martin recevait Jean-Marc Jancovici, président du conseil d’administration de The Shift Project 20, pour aborder la question du coût environnemental du numérique 21. Il ressort de son intervention que nos usages numériques ne sont pas soutenables 22. Beaucoup de chiffres sont avancés à l’appui de cette affirmation. Le but n’est pas ici de les reproduire in extenso, ils sont aisément consultables sur le site du laboratoire mentionné en note. Notons simplement, selon un rapport cité au cours de l’émission, que « ce secteur est responsable aujourd’hui de 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre et [que] la forte augmentation des usages laisse présager un doublement de cette empreinte carbone d’ici 2025 » 23. Les facteurs de surconsommation sont à la fois structurels (voracité énergétique des centres de données, des infrastructures réseau et des terminaux domestiques) et comportementaux (explosion du trafic de données, particulièrement de la vidéo, dont les chats crétins et la pornographie constituent une part toujours croissante). Les hébergeurs et opérateurs traditionnels sont peu diserts sur les performances énergétiques de leurs services. Une recherche Internet avec les mots-clefs « OVH » et « impact environnemental » ou « écologi(qu)e », à la date du 1er février 2020, ne renvoie qu’à des pages du site de l’hébergeur OVH devenues inaccessibles. À cette même date, les mêmes mots sont absents de la page principale et des pages secondaires de l’entrée de menu « à propos » sur le site de la firme 24. Si l’opérateur français Orange met en avant son engagement environnemental en publiant le pourcentage de ses réductions d’émission d’oxyde de carbone 25, très majoritairement imputables à ses centres de données, il ne dit pourtant pas à combien de tonnes par an se montent ces rejets. Un autre rapport sur l’impact spatial et énergétique des centres de données montre pourtant l’ampleur des répercussions de ces infrastructures sur notre cadre de vie 26. En réaction commencent à apparaître des opérateurs de petite taille basant leur communication sur une prise de responsabilité environnementale 27. Sont-ils fiables ? Efficaces ? À distance raisonnable de chez nous ? Cela reste à explorer au cas par cas, car hormis l’hypothèse de l’abstinence, toute solution aux problèmes posés ici dépend des usages de chacun. Mais on peut vouloir faire intervenir ces considérations dans le choix de son hébergeur.
Néanmoins l’énergie la moins polluante étant celle qui n’est pas consommée, on peut aussi souhaiter se préoccuper du bilan de notre site lui-même à cet égard, et réfléchir à la quantité de données générées et transférées par son utilisation, dans l’optique de la réduire. Autrement dit, on peut essayer de tendre vers ce qu’on pourrait nommer une « frugalité numérique » 28. Mon tout premier site, images comprises, pesait moins de 5 mégaoctets. Aujourd’hui, le cœur de WordPress dans sa version 5.3.2 est un téléchargement de 12,8 mégaoctets occupant 50,9 mégaoctets d’espace disque une fois décompressé, et ce avant même d’y avoir installé le moindre thème, la moindre extension, et mis en ligne la moindre image.
J’ignore quelle proportion des fichiers de WordPress est réellement sollicitée par le navigateur pour faire tourner un site simple dans un usage commun – typiquement, un blog personnel unilingue. Je n’ai pas trouvé d’information sur cette question. Ce qui est certain, c’est que de nombreuses extensions multilingues incluent les fichiers de traduction de leur interface dans des dizaine de langues, dont seuls un voire deux seront utilisés sur la plupart des sites. Les autres encombrent ainsi des serveurs partout sur la planète sans jamais servir. Combien existe-t-il d’exemples du même type dans le système WordPress ? Je pense que la question mérite qu’on s’y penche.
Un comportement de WordPress qui m’a d’emblée étonné, c’est la quantité d’images fabriquées par ce logiciel. Pour chaque image ajoutée au site, il crée une douzaine de versions de cette image, de différentes tailles et formats, afin de permettre au navigateur d’afficher celle dont les dimensions et le poids sont les plus cohérents avec la taille de l’écran, et donc de l’afficher le plus vite possible. Pour une image plein écran de deux mille pixels de large au format jpeg de bonne qualité pesant six cents kilooctets, ce sont plus de deux mégaoctets d’images qui sont produits et stockés sur le serveur. Si l’on prend soin de compresser correctement une telle image pour un affichage sur Internet, on peut réduire l’originale à cent cinquante kilooctets, et la totalité des images créées par WordPress à moins de quatre cents kilooctets, ce qui reste élevé. Combien de ces variantes seront-elles effectivement affichées par les visiteurs ? Je n’en sais rien non plus. En revanche, les journaux de connexion à la base de données fournis par l’hébergeur montrent que des robots chinois, américains ou coréens les analysent toutes et régulièrement, créant ainsi du transfert de données sans aucun lien avec la finalité de mon site.
De plus, les sauvegardes automatiques des fichiers du site et de la base de données, exécutées par l’hébergeur ou produites par une extension spécialisée, occupent également de l’espace sur des serveurs et génèrent également du trafic. Pareillement, l’utilisation du tableau de bord de WordPress crée un important flux de données. En effet, chaque fois que je clique sur un bouton, que j’affiche une page, une liste d’éléments ou que j’enregistre une modification, j’envoie une requête vers une base de données installée sur un serveur à Gravelines (Nord), lequel me renvoie une réponse. Cela ne se fait pas sans dépense d’énergie.
Or les sites conçus avec WordPress représentent aujourd’hui plus de trente-cinq pourcents des sites accessibles sur Internet 29, ce qui représente plusieurs dizaines de millions de sites. Je serais curieux de savoir quelle quantité de données inertes sont stockées dans les centres de données de par le monde uniquement par les sites WordPress, quelle quantité de trafic non directement lié à l’utilisation du site par le public cela génère-t-il, et à quelles émissions de gaz à effet de serre cela correspond-il.
À tout le moins, la réalité des infrastructures numérique démentent la dématérialisation du monde dans laquelle ces techniques nous engageraient, et que la publicité liée à ce secteur aime à nous vendre. Ces flux ne voyagent pas de l’éther à l’éther. Il n’y a rien de plus matériel que notre univers connecté.
*
Alors repartir à zéro signifie peut-être dans un premier temps renoncer à WordPress et chercher une autre solution. Je précise que je ne l’ai pas encore trouvée, et que ce texte se termine donc dans l’indécision, quoique sur un terrain en partie débroussaillé. C’est dans cet état d’esprit que je me suis penché sur quelques sites dits « minimalistes ». Tant qu’à faire sobre, comme je l’évoquais plus haut, il doit être possible de faire résolument plus sobre. On peut sans doute afficher moins d’images, recourir à moins d’effets, installer moins de carrousels d’images au goût douteux, utiliser des polices de caractères existant sur toutes les machines et ne devant donc pas être téléchargées à chaque usage, préparer mieux ses images pour qu’elles aient une taille plus adaptées et un poids plus raisonnable. Nous n’en sommes tout de même plus à l’âge d’Internet où la sophistication graphique d’un site est un gage d’être mieux repéré ou davantage regardé. Bien sûr son apparence dit quelque chose, mais si elle dit « sobriété » en faisant discrètement place au contenu, peut-être est-ce suffisant ? Techniquement, on peut même imaginer que davantage de sobriété graphique s’accompagne d’une plus grande légèreté informatique.
Ces recherches m’ont mené à un article de Gauthier Roussilhe intitulé « Guide de conversion numérique au low tech » 30. Il existe donc un mouvement, certes minoritaire mais non nul, tendant à une cure d’amaigrissement des sites. L’auteur propose différentes alternatives allant en ce sens : les CMS n’utilisant pas de base de données, tel Kirby 31, un thème wordpress ultraléger, Susty 32, une meilleure préparation des contenus, ou encore le recours aux pages HTML statiques via différents outils de conversion : « Pour le dire simplement, un site statique pre-génère toutes ses pages en HTML et les envoie telles quelles. Un site dynamique génère la page à chaque visite. Un site statique, c’est une page générée une fois pour 1000 requêtes, un site dynamique c’est une page générée 1000 fois pour 1000 requêtes. Alors un site low tech c’est forcément un site statique. »33 En outre, un site statique peut être créé et mis à jour en local, est moins vulnérable, requiert un moindre entretien, se passe de sauvegardes en ligne… En bref, le même site, produisant la même « expérience visiteur », pour utiliser un barbarisme à la mode, peut être obtenu avec des techniques et des CMS aux performances environnementales très disparates. Écologiquement c’est évidemment une goutte d’eau. Mais e n’est pas une raison pour s’abstenir.
J’ai commencé par essayer Kirby. Même si je suis parvenu à certains résultats j’ai trouvé cet outil a priori trop difficile pour mon niveau de connaissance et davantage dédié aux développeurs en informatique. D’autres CMS similaires, dits « flat-file », existent 34. Je poursuivrai mes recherche dans cette direction-là pour trouver un outil à ma portée. Tâche pour laquelle je ne suis pas formé, et qui demandera donc encore du temps, ou de l’aide, ou les deux. J’avance en aveugle. Au bout du compte, j’aimerais que le résultat de ce temps passé soit, tant que faire se peut, la longévité et la simplicité du système choisi, et un mode de fonctionnement visant à réduire au strict nécessaire l’espace que ce site occupe et les données qu’il transporte. J’espère surtout réduire le temps de cerveau que me coûte la volonté assumée de maintenir une présence en ligne, pour pouvoir faire autre chose à la place l’esprit un peu léger, dégagé des échéances de mises à jour.
Je ne sais si cela a un sens, surtout pour un site présentant des photographies. On verra bien. Peut-être certaines des pistes évoquées ici ouvriront en outre des solutions pour l’un ou l’autre lecteur confronté à des questions similaires. Je serai heureux de le savoir. Pour ma part, si ce blog survit à ce chantier, je ne manquerai pas de compléter ce texte en conséquence.
1 Michel de Certeau, L’Invention du quotidien. 1. arts de faire [1979], Paris, Gallimard, coll. Folio essais, 1990, p. 13.
2 https://www.icann.org/fr. Consulté le 17 février 2020.
3 Wikipédia, « Internet Corporation for Assigned Names and Numbers » [en ligne]. Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_Corporation_for_Assigned_Names_and_Numbers. Consulté le 25 janvier 2020.
4 Wikipédia, « Hypertext Markup Language » [en ligne]. Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Markup_Language. Consulté le 25 janvier 2020.
5 Le mot « besoin » reste pour moi incongru dans un contexte aussi futile. On a besoin d’eau, de pain, de soins, d’un toit, de relations, et de bien d’autres choses, mais personne n’a « besoin » d’un site Internet. Ce n’est jamais qu’un outil lié à un loisir ou une activité culturelle ou professionnelle. N’ayant toutefois pas trouvé d’autre terme pour désigner les attentes formulées à l’égard de cet outil, je continuerai à l’utiliser dans la suite de ce texte, en m’abstenant toutefois d’entourer de guillemets chacune de ses occurrence.
6 Wikipédia, « Active Server Pages » [en ligne]. Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Active_Server_Pages. Consulté le 25 janvier 2020.
7 Wikipédia, « PHP » [en ligne]. Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/PHP. Consulté le 25 janvier 2020.
8 Wikipédia, « Feuilles de style en cascade » [en ligne]. Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Feuilles_de_style_en_cascade. Consulté le 25 janvier 2020.
9 Ivan Illich, La Convivialité, Paris, éditions du Seuil, 1973.
10 Wikipédia, « WordPress » [en ligne]. Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/WordPress. Consulté le 25 janvier 2020.
11 Le « cœur », ou « noyau » (« core » en anglais), est l’ensemble des fichiers qui composent le logiciel libre WordPress. Le « thème » est un ensemble de fichiers qui définissent l’apparence graphique du site et paramètrent certaines fonctionnalités inhérentes à WordPress, de façon plus ou moins personnalisables par l’utilisateur. Une « extension » est un ensemble de fichiers qui ajoute à WordPress des fonctionnalités qui ne sont pas prévues dans le cœur.
12 Marie Richeux (prod.), Jean-Louis Comolli. Pas la Peine de crier [émission radiophonique]. France Cutlure, 2 janvier 2012. Disponible en ligne sur : https://www.franceculture.fr/emissions/pas-la-peine-de-crier/jean-louis-comolli. Consulté le 1er février 2020.
13 Wikipédia, « Optimisation pour les moteurs de recherche » [en ligne]. Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Optimisation_pour_les_moteurs_de_recherche. Consulté le 25 janvier 2020.
14 Frédéric Lecloux, « Le Bruit de fond anonyme du monde », Aux Bords du cadre [en ligne], 17 juin 2018. Disponible sur https://www.fredericlecloux.com/le-bruit-de-fond-anonyme-du-monde/. Consulté le 17 février 2020.
15 Wikipédia, « RSS » [en ligne]. Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/RSS. Consulté le 25 janvier 2020. Ce système permet normalement à la personne qui s’abonne au « flux RSS » d’un site, de recevoir un courriel quand de nouveaux articles sont publiés sur le site. Cependant, depuis fin 2018, le navigateur Firefox rend obligatoire l’installation d’une extension pour pouvoir utiliser de ce service. Safari également réclame l’installation d’un « lecteur de flux rss ». Il semble donc que cet outil soit en train d’être marginalisé.
16 Frédéric Lecloux, « Territoires du cinématographe I », op.cit., 10 janvier 2020. Disponible sur https://www.fredericlecloux.com/territoires-du-cinematographe-i/. Consulté le 17 février 2020.
17 « Une roue dans le fossé, et une sur la route » (c’est moi qui traduis). Neil Young, « Alabama », in Harvest [disque microsillon], Burbank, Reprise Records, 1er février 1972.
18 Frédéric Lecloux, « Territoires du cinématographe I », op.cit.
19 Paolo Sorrentino (réal.), La Grande bellezza [film], Medusa Films (prod.), 142 min., 2013.
20 The Shift Project est un laboratoire d’idées œuvrant en faveur d’une économie libérée de la contrainte carbone à l’origine du rapport cité ci-dessus. En ligne : https://theshiftproject.org. Consulté le 17 février 2020.
21 Nicolas Martin (prod.), Consommation numérique : la fabrique à CO2(.0). La Méthode scientifique [émission radiophonique], France Culture, 17 octobre 2018. Disponible en ligne sur : https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/consommation-numerique-la-pompe-a-co20. Consulté le 17 février 2020.
22 Voir notamment : Groupe de travail Lean ICT, Hugues Ferrebœuf (dir.), Pour une Sobriété numérique [en ligne], The Shift Project, 4 octobre 2018. Disponible sur: https://theshiftproject.org/article/pour-une-sobriete-numerique-rapport-shift/. Consulté le 17 février 2020.
23 La Face cachée du numérique [en ligne], Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie, coll. Clés pour agir, 15 juin 2017. Disponible sur : https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf. Consulté le 17 février 2020.
24 OVH, « À propos » [en ligne]. Disponible sur : https://www.ovhcloud.com/fr/about-us/. « Qui sommes-nous? » [en ligne]. Disponible sur : https://www.ovhcloud.com/fr/about-us/who-are/. « Notre organisation » [en ligne]. Disponible sur : https://www.ovhcloud.com/fr/about-us/how-do-it/. Consultés le 1er février 2020.
25 Orange, « Orange France, certifié pour son engagement environnemental » [en ligne]. Disponible sur : https://bienvivreledigital.orange.fr/bibliotheque/environnement-certification/. Consulté le 1er février 2020.
26 Cécile Diguet, Fanny Lopez (dir.), L’impact spatial et énergétique des data centers sur les territoires [en ligne], Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie, février 2019. Disponible sur : https://www.ademe.fr/impact-spatial-energetique-data-centers-territoires-l. Consulté le 1er février 2020.
27 Top 10 Hébergeurs, « Hébergement vert / Hébergement écologique » [en ligne]. Disponible sur https://www.top10hebergeurs.com/categorie/hebergement-ecologique.html. Consulté le 1er février 2020.
28 J’ai pensé à cette expression de « frugalité numérique » en écrivant ce texte, pour décrire une manière possible d’ « être en ligne » et d’utiliser Internet, évidemment inspiré par Nicolas Bouvier qui affectionnait ce mot de « frugalité ». Me demandant si elle était déjà en usage, j’ai fait une recherche Google, laquelle renvoie au 25 janvier 2020 environ 815 résultats en français pour l’expression entière (recherche avec guillemets), dont 80 résultats non redondants seulement. Le site du Shift Project mentionné plus haut parle quant à lui de « sobriété numérique ».
29 Kinsta, « Part de marché de WordPress » [en ligne]. Disponible sur : https://kinsta.com/fr/part-de-marche-de-wordpress/. Consulté le 1er février 2020.
30 Gauthier Roussilhe, « Guide de conversion numérique au low tech » [en ligne]. Disponible sur : http://gauthierroussilhe.com/fr/posts/convert-low-tech. Consulté le 17 février 2020.
31 https://getkirby.com. Consulté le 17 février 2020.
32 https://sustywp.com. Consulté le 17 février 2020.
33 Gauthier Roussilhe, op.cit.
34 Joel Hans, « WordPress alternatives: 12 best flat file CMS » [en ligne], Serverwise: the SSD Nodes blog, 4 juin 2019. Disponible sur https://blog.ssdnodes.com/blog/flat-file-wordpress-alternatives/. Consulté le 17 février 2020.
Photographie : capture d’écran, souvenir des années non-adaptatives.

